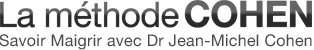Traces de médicaments, plomb ou nitrates… L’eau de votre robinet est-elle suffisamment contrôlée ? Quels sont les risques de contamination ? Y a-t-il des régions plus à risques ? Peut-on se protéger ? Nous avons mené l’enquête
Traces de médicaments, plomb ou nitrates… L’eau de votre robinet est-elle suffisamment contrôlée ? Quels sont les risques de contamination ? Y a-t-il des régions plus à risques ? Peut-on se protéger ? Nous avons mené l’enquête
Des régions plus à risques
 La qualité de l’eau est moins contrôlée dans les campagnes et les zones montagneuses. Pourquoi ? Parce qu’elles sont moins peuplées. "Le contrôle sanitaire est proportionnellement moins important car les volumes pompés et la population sont moins importants", atteste Adeline Savy, ingénieur du génie sanitaire à la Ddass de l’Essonne, l’organisme responsable du contrôle de la qualité de l’eau.
La qualité de l’eau est moins contrôlée dans les campagnes et les zones montagneuses. Pourquoi ? Parce qu’elles sont moins peuplées. "Le contrôle sanitaire est proportionnellement moins important car les volumes pompés et la population sont moins importants", atteste Adeline Savy, ingénieur du génie sanitaire à la Ddass de l’Essonne, l’organisme responsable du contrôle de la qualité de l’eau.
Pourtant, ces régions ont plus de risques d’être contaminées car elles concentrent des terres agricoles. "L’agriculture est une source de contamination des nappes souterraines [zone majoritaire de prélèvement d’eau] par les pesticides et les nitrates", selon Michèle Jarret, responsable de la règlementation au laboratoire Santé environnement hygiène de Lyon.
2. Des pollutions à la source…
 Assurer la potabilité de l’eau, c’est avant tout protéger des pollutions les zones d’où elle est extraite. Selon la loi du 3 janvier 1992, tous les points de captages doivent obligatoirement avoir un périmètre de protection (une clôture, entre autres)...
Assurer la potabilité de l’eau, c’est avant tout protéger des pollutions les zones d’où elle est extraite. Selon la loi du 3 janvier 1992, tous les points de captages doivent obligatoirement avoir un périmètre de protection (une clôture, entre autres)...
Pourtant en 2004, seuls 40 % d’entre elles étaient protégées… Le gouvernement s’est engagé, dans son Plan national santé environnement (2004), à ce que 80 % des zones le soient d’ici 2008. Mais à ce jour ni le ministère de la Santé, ni le ministère de l’Ecologie n’ont été en mesure de nous dire ce qu’il en est exactement. Pour André Levassor, hydrogéologue, "il serait fort étonnant que 80 % de champs de captages soient pourvus d’un périmètre de protection réellement efficaces. Dans la région parisienne, on doit être très en dessous".
Nitrates : il y en a encore !
 Rejets urbains et industriels, engrais… Les causes de pollution aux nitrates sont aujourd’hui bien identifiées. Pourtant, ces substances chimiques qui, à fortes doses, peuvent être toxiques pour l’organisme (risques de cancer), sont encore présentes dans l’eau de consommation ! Sur les 20 000 installations (stations de traitement ou lieux d’extraction) contrôlées en France en 2006, 867 ont d’ailleurs présenté des taux en nitrates supérieurs à la limite fixée par l’OMS (50 mg/l). De plus, 97 % des dépassements observés concernent les eaux souterraines. Or, environ 70 % de l’eau du robinet provient de ces eaux (le reste provenant des eaux de surface (fleuves, rivières) !
Rejets urbains et industriels, engrais… Les causes de pollution aux nitrates sont aujourd’hui bien identifiées. Pourtant, ces substances chimiques qui, à fortes doses, peuvent être toxiques pour l’organisme (risques de cancer), sont encore présentes dans l’eau de consommation ! Sur les 20 000 installations (stations de traitement ou lieux d’extraction) contrôlées en France en 2006, 867 ont d’ailleurs présenté des taux en nitrates supérieurs à la limite fixée par l’OMS (50 mg/l). De plus, 97 % des dépassements observés concernent les eaux souterraines. Or, environ 70 % de l’eau du robinet provient de ces eaux (le reste provenant des eaux de surface (fleuves, rivières) !
Les régions à risques : Pays-de-la-Loire, Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne, Centre, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées
4. De plus en plus de résidus de médicaments dans l’eau ?
 En octobre 2008, la Direction générale de la santé (DGS) annonçait avoir identifié une vingtaine de molécules médicamenteuses dans des eaux prélevées sur 141 sites entre 2006 et 2007. Un résultat inquiétant sachant que certaines de ces substances pourraient perturber l’équilibre hormonal (troubles de la reproduction et transformations des organes sexuels ont été observés chez des poissons) ou entraîner une résistance aux antibiotiques. "Dans les eaux de rivières [d’où provient 40 % de l’eau], on trouve de plus en plus de traces de médicaments qui ne sont pas éliminés par les systèmes actuels d’épuration", regrette André Levassor, hydrogéologue. L’Afssaps, l’Afssa la DGS et les agences de l’eau se sont engagées à améliorer les techniques de traitement. Espérons des mesures rapides…
En octobre 2008, la Direction générale de la santé (DGS) annonçait avoir identifié une vingtaine de molécules médicamenteuses dans des eaux prélevées sur 141 sites entre 2006 et 2007. Un résultat inquiétant sachant que certaines de ces substances pourraient perturber l’équilibre hormonal (troubles de la reproduction et transformations des organes sexuels ont été observés chez des poissons) ou entraîner une résistance aux antibiotiques. "Dans les eaux de rivières [d’où provient 40 % de l’eau], on trouve de plus en plus de traces de médicaments qui ne sont pas éliminés par les systèmes actuels d’épuration", regrette André Levassor, hydrogéologue. L’Afssaps, l’Afssa la DGS et les agences de l’eau se sont engagées à améliorer les techniques de traitement. Espérons des mesures rapides…
5. Plomb : attention aux anciennes canalisations !
 34 % des logements en France en sont encore équipés de canalisations en plomb... bien que l’utilisation de ce dernier soit interdite depuis 1995 ! Et le plomb est encore présent dans 3,4 millions de branchements transportant l’eau au robinet. "La majorité des anomalies que nous détectons sont dues à la dégradation de l’eau dans les réseaux comme ceux en plomb", explique Sylvie Rauzy, du Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris. Le plomb peut être responsable de saturnisme (intoxications), de douleurs abdominales, de troubles neurologiques, d’anémies et même d’hypertension.
34 % des logements en France en sont encore équipés de canalisations en plomb... bien que l’utilisation de ce dernier soit interdite depuis 1995 ! Et le plomb est encore présent dans 3,4 millions de branchements transportant l’eau au robinet. "La majorité des anomalies que nous détectons sont dues à la dégradation de l’eau dans les réseaux comme ceux en plomb", explique Sylvie Rauzy, du Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris. Le plomb peut être responsable de saturnisme (intoxications), de douleurs abdominales, de troubles neurologiques, d’anémies et même d’hypertension.
A noter : la teneur en plomb ne doit pas dépasser 25 μg/l (une limite qui devrait être abaissée à 10 μg/l en 2013). Les teneurs en plomb de l’eau de consommation sont disponibles en mairie
Bactéries, virus : des risques de contamination

"La recherche dans l’eau de tous les micro-organismes potentiellement dangereux est irréaliste, tant pour des raisons techniques qu’économiques", explique le ministère de la Santé Voilà pourquoi l’eau peut parfois entraîner, comme ce fut le cas dans l’Ain (2003) et en Saône-et-Loire (2001), des cas de gastro-entérites.
A noter : "Les
épidémies d’origine hydrique rapportées en France sont très rares", précise le ministère de la Santé. 96 % des prélèvements effectués en 2006 sur 25 000 unités de distribution* (la France en compte environ 27 000) ont confirmé l’
absence de contamination microbiologique.
*Une unité de distribution est une zone géographique gérée par une même structure et délivrant une eau de même qualité
Chlore : ne paniquez pas !
 Ce n’est pas parce que l’eau que vous buvez "sent" le chlore qu’elle n’est pas potable ! Au contraire, si les distributeurs d’eau en ajoutent c’est parce que le chlore prévient la multiplication des germes lors du transport de l’eau. Il est donc normal d’en trouver dans l’eau de consommation… à condition bien sûr que ce ne soit pas en excès ! "La consigne de taux de chlore est de 0,4 mg/l en sortie d’usine et d’environ 0,1 mg/l au robinet du consommateur", explique Véronique Heim, responsable des études au Sedif Selon l’OMS, le chlore ne présente pas de danger pour la santé à moins de 5 mg/l.
Ce n’est pas parce que l’eau que vous buvez "sent" le chlore qu’elle n’est pas potable ! Au contraire, si les distributeurs d’eau en ajoutent c’est parce que le chlore prévient la multiplication des germes lors du transport de l’eau. Il est donc normal d’en trouver dans l’eau de consommation… à condition bien sûr que ce ne soit pas en excès ! "La consigne de taux de chlore est de 0,4 mg/l en sortie d’usine et d’environ 0,1 mg/l au robinet du consommateur", explique Véronique Heim, responsable des études au Sedif Selon l’OMS, le chlore ne présente pas de danger pour la santé à moins de 5 mg/l.
Comment éviter l’odeur de chlore ? Laissez couler l’eau quelques dizaines de secondes avant de la boire, mettez-la dans une carafe ou rafraîchissez-la au réfrigérateur.


 Traces de médicaments, plomb ou nitrates… L’eau de votre robinet est-elle suffisamment contrôlée ? Quels sont les risques de contamination ? Y a-t-il des régions plus à risques ? Peut-on se protéger ? Nous avons mené l’enquête
Traces de médicaments, plomb ou nitrates… L’eau de votre robinet est-elle suffisamment contrôlée ? Quels sont les risques de contamination ? Y a-t-il des régions plus à risques ? Peut-on se protéger ? Nous avons mené l’enquête La qualité de l’eau est moins contrôlée dans les campagnes et les zones montagneuses. Pourquoi ? Parce qu’elles sont moins peuplées. "Le contrôle sanitaire est proportionnellement moins important car les volumes pompés et la population sont moins importants", atteste Adeline Savy, ingénieur du génie sanitaire à la Ddass de l’Essonne, l’organisme responsable du contrôle de la qualité de l’eau.
La qualité de l’eau est moins contrôlée dans les campagnes et les zones montagneuses. Pourquoi ? Parce qu’elles sont moins peuplées. "Le contrôle sanitaire est proportionnellement moins important car les volumes pompés et la population sont moins importants", atteste Adeline Savy, ingénieur du génie sanitaire à la Ddass de l’Essonne, l’organisme responsable du contrôle de la qualité de l’eau. Assurer la potabilité de l’eau, c’est avant tout protéger des pollutions les zones d’où elle est extraite. Selon la loi du 3 janvier 1992, tous les points de captages doivent obligatoirement avoir un périmètre de protection (une clôture, entre autres)...
Assurer la potabilité de l’eau, c’est avant tout protéger des pollutions les zones d’où elle est extraite. Selon la loi du 3 janvier 1992, tous les points de captages doivent obligatoirement avoir un périmètre de protection (une clôture, entre autres)... Rejets urbains et industriels, engrais… Les causes de pollution aux nitrates sont aujourd’hui bien identifiées. Pourtant, ces substances chimiques qui, à fortes doses, peuvent être toxiques pour l’organisme (risques de cancer), sont encore présentes dans l’eau de consommation ! Sur les 20 000 installations (stations de traitement ou lieux d’extraction) contrôlées en France en 2006, 867 ont d’ailleurs présenté des taux en nitrates supérieurs à la limite fixée par l’OMS (50 mg/l). De plus, 97 % des dépassements observés concernent les eaux souterraines. Or, environ 70 % de l’eau du robinet provient de ces eaux (le reste provenant des eaux de surface (fleuves, rivières) !
Rejets urbains et industriels, engrais… Les causes de pollution aux nitrates sont aujourd’hui bien identifiées. Pourtant, ces substances chimiques qui, à fortes doses, peuvent être toxiques pour l’organisme (risques de cancer), sont encore présentes dans l’eau de consommation ! Sur les 20 000 installations (stations de traitement ou lieux d’extraction) contrôlées en France en 2006, 867 ont d’ailleurs présenté des taux en nitrates supérieurs à la limite fixée par l’OMS (50 mg/l). De plus, 97 % des dépassements observés concernent les eaux souterraines. Or, environ 70 % de l’eau du robinet provient de ces eaux (le reste provenant des eaux de surface (fleuves, rivières) ! En octobre 2008, la Direction générale de la santé (DGS) annonçait avoir identifié une vingtaine de molécules médicamenteuses dans des eaux prélevées sur 141 sites entre 2006 et 2007. Un résultat inquiétant sachant que certaines de ces substances pourraient perturber l’équilibre hormonal (troubles de la reproduction et transformations des organes sexuels ont été observés chez des poissons) ou entraîner une résistance aux antibiotiques. "Dans les eaux de rivières [d’où provient 40 % de l’eau], on trouve de plus en plus de traces de médicaments qui ne sont pas éliminés par les systèmes actuels d’épuration", regrette André Levassor, hydrogéologue. L’Afssaps, l’Afssa la DGS et les agences de l’eau se sont engagées à améliorer les techniques de traitement. Espérons des mesures rapides…
En octobre 2008, la Direction générale de la santé (DGS) annonçait avoir identifié une vingtaine de molécules médicamenteuses dans des eaux prélevées sur 141 sites entre 2006 et 2007. Un résultat inquiétant sachant que certaines de ces substances pourraient perturber l’équilibre hormonal (troubles de la reproduction et transformations des organes sexuels ont été observés chez des poissons) ou entraîner une résistance aux antibiotiques. "Dans les eaux de rivières [d’où provient 40 % de l’eau], on trouve de plus en plus de traces de médicaments qui ne sont pas éliminés par les systèmes actuels d’épuration", regrette André Levassor, hydrogéologue. L’Afssaps, l’Afssa la DGS et les agences de l’eau se sont engagées à améliorer les techniques de traitement. Espérons des mesures rapides…  34 % des logements en France en sont encore équipés de canalisations en plomb... bien que l’utilisation de ce dernier soit interdite depuis 1995 ! Et le plomb est encore présent dans 3,4 millions de branchements transportant l’eau au robinet. "La majorité des anomalies que nous détectons sont dues à la dégradation de l’eau dans les réseaux comme ceux en plomb", explique Sylvie Rauzy, du Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris. Le plomb peut être responsable de saturnisme (intoxications), de douleurs abdominales, de troubles neurologiques, d’anémies et même d’hypertension.
34 % des logements en France en sont encore équipés de canalisations en plomb... bien que l’utilisation de ce dernier soit interdite depuis 1995 ! Et le plomb est encore présent dans 3,4 millions de branchements transportant l’eau au robinet. "La majorité des anomalies que nous détectons sont dues à la dégradation de l’eau dans les réseaux comme ceux en plomb", explique Sylvie Rauzy, du Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris. Le plomb peut être responsable de saturnisme (intoxications), de douleurs abdominales, de troubles neurologiques, d’anémies et même d’hypertension. "La recherche dans l’eau de tous les micro-organismes potentiellement dangereux est irréaliste, tant pour des raisons techniques qu’économiques", explique le ministère de la Santé Voilà pourquoi l’eau peut parfois entraîner, comme ce fut le cas dans l’Ain (2003) et en Saône-et-Loire (2001), des cas de gastro-entérites.
"La recherche dans l’eau de tous les micro-organismes potentiellement dangereux est irréaliste, tant pour des raisons techniques qu’économiques", explique le ministère de la Santé Voilà pourquoi l’eau peut parfois entraîner, comme ce fut le cas dans l’Ain (2003) et en Saône-et-Loire (2001), des cas de gastro-entérites. Ce n’est pas parce que l’eau que vous buvez "sent" le chlore qu’elle n’est pas potable ! Au contraire, si les distributeurs d’eau en ajoutent c’est parce que le chlore prévient la multiplication des germes lors du transport de l’eau. Il est donc normal d’en trouver dans l’eau de consommation… à condition bien sûr que ce ne soit pas en excès ! "La consigne de taux de chlore est de 0,4 mg/l en sortie d’usine et d’environ 0,1 mg/l au robinet du consommateur", explique Véronique Heim, responsable des études au Sedif Selon l’OMS, le chlore ne présente pas de danger pour la santé à moins de 5 mg/l.
Ce n’est pas parce que l’eau que vous buvez "sent" le chlore qu’elle n’est pas potable ! Au contraire, si les distributeurs d’eau en ajoutent c’est parce que le chlore prévient la multiplication des germes lors du transport de l’eau. Il est donc normal d’en trouver dans l’eau de consommation… à condition bien sûr que ce ne soit pas en excès ! "La consigne de taux de chlore est de 0,4 mg/l en sortie d’usine et d’environ 0,1 mg/l au robinet du consommateur", explique Véronique Heim, responsable des études au Sedif Selon l’OMS, le chlore ne présente pas de danger pour la santé à moins de 5 mg/l.